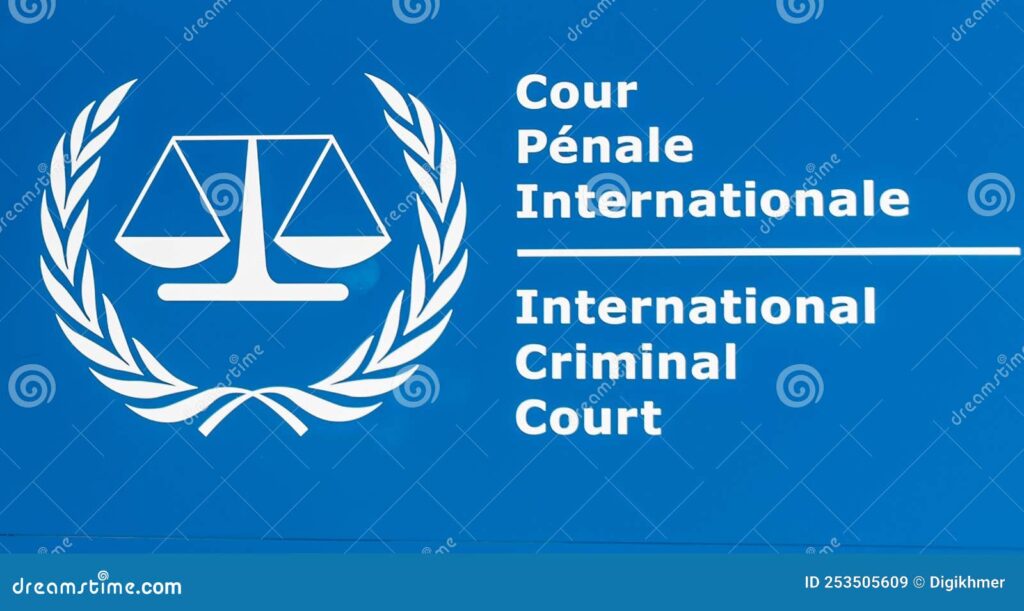Les autorités du Mali, du Burkina Faso et du Niger ont annoncé, le 22 septembre 2025, leur retrait immédiat du Statut de Rome, mettant fin à leur coopération avec la Cour pénale internationale (CPI).
Cette décision marque une rupture géopolitique majeure, au cœur d’un climat de tensions croissantes entre institutions internationales et États africains en quête de souveraineté renforcée. Réunis au sein de la Confédération des États du Sahel (AES), les trois pays reprochent à la CPI une justice sélective, ciblant principalement l’Afrique tout en épargnant certains acteurs internationaux. Ils dénoncent une Cour utilisée comme outil de domination par les puissances occidentales.
Une décision hautement symbolique
Alors que les États membres de l’AES ont rompu avec la France sur les plans militaire et diplomatique depuis 2022–2023, ce retrait de la CPI s’inscrit dans une stratégie de désengagement des structures perçues comme dominées par les anciennes puissances coloniales. La CPI, bien que juridiquement indépendante, est régulièrement critiquée pour avoir ouvert plus de 70% de ses enquêtes sur le continent africain, tout en restant quasi-absente dans d’autres zones de conflit, comme la Palestine ou l’Ukraine orientale.
Cette décision fait également écho aux précédents retraits ou menaces de retrait de la Cour par d’autres États africains, comme le Burundi en 2017 ou les velléités sud-africaines dans les années 2010. Mais c’est la première fois qu’un bloc régional coordonné quitte simultanément la juridiction de la CPI.
Vers une justice sahélienne autonome ?
L’AES affirme vouloir promouvoir des mécanismes endogènes pour assurer paix, justice et droits humains, tout en restant ouverte à la coopération internationale dans d’autres cadres notamment à travers d’autres forums multilatéraux « plus respectueux de l’équilibre des relations internationales [et] ancrés dans des valeurs africaines ». Ce positionnement illustre la montée en puissance d’un discours panafricaniste assumé, qui entend redéfinir les termes de la gouvernance mondiale. Une décision qui s’inscrit dans une dynamique souverainiste croissante et pourrait accentuer la crise de légitimité que traverse la CPI.
Une onde de choc pour la justice internationale ?
Ce retrait simultané pose de sérieuses questions à la CPI, déjà confrontée à une crise de légitimité et à une érosion de la confiance des pays du Sud. Alors que la Cour tente de se redéployer sur d’autres théâtres (comme l’Ukraine, la Libye ou la Syrie), la perte de trois États membres stratégiques du Sahel pourrait affaiblir sa capacité à agir dans une région minée par l’insécurité et le terrorisme.
Si certains observateurs redoutent un vide judiciaire dans la zone sahélienne, d’autres y voient un signal fort pour repenser le fonctionnement des institutions internationales, souvent jugées asymétriques et insensibles aux réalités locales.
Ce retrait pourrait-il faire tache d’huile en Afrique ? Quels mécanismes alternatifs de justice les pays de l’AES développeront-ils ? Et surtout, la CPI réformera-t-elle son approche pour restaurer sa légitimité face au Sud global ?