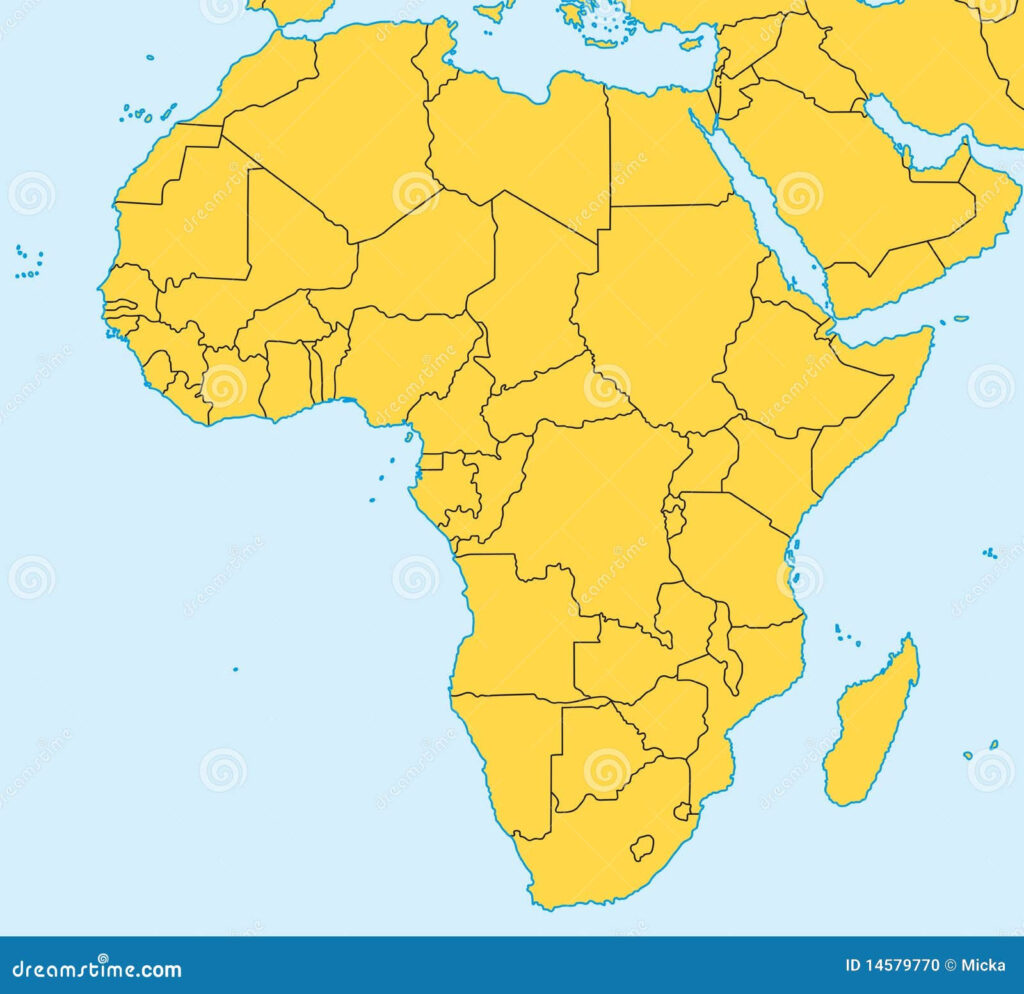Et si l’Afrique n’était pas seulement sous-évaluée économiquement et politiquement, mais aussi… cartographiquement ?
À l’occasion de la Biennale Euro-Africa, chercheurs, diplomates et cartographes ont soulevé un point essentiel : notre vision du continent est biaisée, car faussée dès la représentation géographique que nous en avons.
Au cœur du problème : la projection de Mercator. Conçue au XVIe siècle pour la navigation maritime européenne, elle demeure largement utilisée dans les manuels scolaires et les outils de géolocalisation modernes. Cette projection déforme la réalité en agrandissant artificiellement les régions proches des pôles, comme l’Europe ou l’Amérique du Nord, et en réduisant celles situées près de l’équateur – en particulier l’Afrique.
Résultat : une perception erronée, mais profondément ancrée. Sur ces cartes, le Groenland semble aussi vaste que l’Afrique, alors qu’il est en réalité quatorze fois plus petit. L’Afrique, elle, couvre plus de 30 millions de km². Elle pourrait contenir les États-Unis, la Chine, l’Inde, le Japon et toute l’Europe de l’Ouest – ensemble. Pourtant, dans l’imaginaire collectif mondial, elle reste souvent perçue comme un continent « petit », marginal, voire périphérique.
Cette distorsion visuelle n’est pas sans conséquences. Comme le rappelle la géographe Vanessa Ehouman : « L’Afrique n’a jamais été petite. C’est notre regard qui l’a rétrécie ». Une carte biaisée produit un imaginaire biaisé. Elle influence les décisions politiques, les investissements économiques, la manière dont les citoyens du monde – y compris les Africains eux-mêmes – perçoivent le continent.
« Cartographier, c’est exercer du pouvoir », affirme le géographe Philippe Rekacewicz. Une carte n’est pas neutre : elle hiérarchise l’espace, oriente les regards et donc les priorités. À l’heure où l’Afrique devient un centre stratégique global – avec une population jeune, des ressources naturelles abondantes, des terres arables, un dynamisme entrepreneurial – il est temps de lui rendre sa véritable place sur la carte… et dans les esprits.
Face à cela, des alternatives émergent : la projection Gall-Peters, plus fidèle aux surfaces réelles ; des cartes centrées sur l’Afrique ; des visualisations basées sur des flux Sud-Sud ; ou encore des cartes construites à partir de données africaines (infrastructures, réseaux logistiques, zones économiques).
Ces initiatives ne visent pas seulement à corriger une image : elles participent d’un mouvement plus large de réappropriation cognitive. L’Union africaine, des ONG, des gouvernements et des universités africaines militent pour une cartographie plus juste, en phase avec des projets ambitieux tels que la ZLECAf, l’intégration numérique ou l’Union monétaire.
Redessiner la carte, ce n’est pas effacer les frontières, mais replacer l’Afrique au centre d’un monde qu’elle contribue à façonner. C’est reconnaître sa véritable échelle, sa puissance démographique, économique et culturelle. Une carte juste n’est pas qu’un outil géographique : c’est un pas vers un monde plus équitable, plus lucide, plus équilibré.