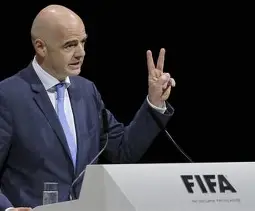Le Cameroun face au défi du football scolaire : un modèle à construire ?
Tandis que le Niger et la Centrafrique innovent avec la FIFA, le Cameroun reste en retrait dans l’intégration du football comme levier de développement éducatif et social. Le 26 juillet 2025, le Niger est devenu l’un des deux premiers pays africains à signer avec la FIFA le programme « Football for Schools », un accord ambitieux visant à intégrer le football dans le système scolaire. Cette initiative, qui combine formation des enseignants, contenus pédagogiques, tournois et suivi évaluation, est saluée comme un pas décisif vers une éducation plus inclusive, citoyenne et ancrée dans les réalités sociales des jeunes Africains. En comparaison, le Cameroun, pourtant grande nation de football, n’a pas encore entamé une démarche structurelle similaire. Certes, des initiatives existent à travers certaines ONG locales, clubs formateurs ou projets ponctuels de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot), mais elles demeurent isolées et sans ancrage institutionnel dans l’éducation nationale. Pourtant, les enjeux sont immenses. Le Cameroun compte plus de 10 millions de jeunes de moins de 25 ans, soit plus de 40 % de la population. Dans un contexte de chômage des jeunes évalué à plus de 13 %, et d’un secteur informel où l’emploi précaire domine, l’encadrement des jeunes par le sport apparaît comme une piste d’inclusion et de mobilisation sociale sous-exploitée. Des experts comme Patrick Mboma, ancien international reconverti dans le développement sportif, appellent à « faire du football un outil de citoyenneté et d’éducation ». Il plaide pour une coopération étroite entre le ministère de l’Éducation, celui des Sports et la Fécafoot, afin d’implémenter un modèle adapté au contexte camerounais. Au-delà du développement personnel, une telle politique pourrait stimuler la création d’emplois dans la filière sportive, renforcer les infrastructures locales et favoriser une diplomatie sportive régionale. La réussite du Niger pourrait donc servir de révélateur pour le Cameroun : et si l’avenir du football camerounais passait par l’école ?
Le Cameroun face au défi du football scolaire : un modèle à construire ? Read More »