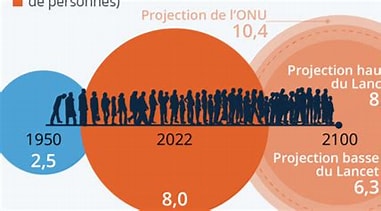Le retrait des États-Unis de l’UNESCO : une fenêtre stratégique pour l’Afrique et la candidature de Firmin Édouard Matoko
Le retrait annoncé des États-Unis de l’UNESCO, prévu pour entrer en vigueur fin 2026, ouvre une phase charnière pour l’avenir de la gouvernance culturelle mondiale. Ce désengagement américain, à la fois symbolique et structurel, redéfinit les rapports de force au sein de l’organisation. Il crée un espace stratégique que des puissances moyennes et émergentes, en particulier africaines, cherchent désormais à investir. Dans ce contexte, la candidature du Congolais Firmin Édouard Matoko à la direction générale de l’UNESCO en novembre prochain, prend une dimension nouvelle, à la croisée de la diplomatie Sud-Sud, des enjeux géoéconomiques liés à la culture et de la reconfiguration du multilatéralisme mondial. Une recomposition diplomatique en cours Historiquement, les États-Unis ont pesé lourdement sur les orientations de l’UNESCO, tant par leur contribution budgétaire que par leur capacité d’influence sur les normes culturelles et éducatives globales. Leur retrait marque une perte d’équilibre traditionnel, au profit d’acteurs plus discrets mais déterminés à renforcer le poids du multilatéralisme inclusif. La Chine, l’Inde, les pays du Golfe et plusieurs États africains investissent aujourd’hui les arènes culturelles internationales comme levier de projection de puissance douce. Dans ce vide relatif laissé par Washington, la candidature de Firmin Édouard Matoko, fort de plus de trente ans d’expérience à l’UNESCO, s’impose comme une réponse légitime et stratégique à une demande croissante d’un leadership décentré, porté par les réalités du Sud global. Matoko a su incarner au sein de l’organisation la vision d’une Afrique actrice et non spectatrice, particulièrement à travers son mandat comme sous-directeur général pour la priorité Afrique et les relations extérieures. Une vision panafricaine adaptée aux enjeux globaux La vision défendue par Matoko repose sur une redéfinition des priorités éducatives, scientifiques et culturelles à l’aune des défis africains – mais également transversaux : transformation numérique, intelligence artificielle inclusive, préservation des savoirs endogènes, cohésion sociale, sécurité culturelle dans les zones fragiles. Son initiative phare, Africa Lab, vise à faire de l’Afrique un incubateur d’innovations éducatives et culturelles adaptables aux autres régions du monde. Il s’agit là d’une logique de « co-construction normative« , à rebours des approches descendantes souvent critiquées dans la gouvernance internationale. Le multilatéralisme culturel à l’épreuve des fractures globales L’élection du prochain directeur général, attendue pour fin 2025 à Samarcande, se tiendra dans un contexte de polarisation géopolitique croissante, marqué par les guerres informationnelles, le repli souverainiste, mais aussi la montée de revendications pour un multilatéralisme plus équitable. Dans ce contexte, l’UNESCO reste l’un des rares espaces onusiens où la diplomatie culturelle peut encore désamorcer certaines tensions, à condition d’être portée par une vision équilibrée, représentative et capable de s’adapter aux réalités du XXIe siècle. La candidature Matoko, en capitalisant sur la sortie américaine, peut ainsi incarner une alternative crédible à une gouvernance polarisée ou trop technocratique. Vers une reconfiguration du leadership mondial de l’UNESCO Au-delà de l’enjeu personnel, la possible élection d’un dirigeant africain à la tête de l’UNESCO aurait une portée historique. Elle marquerait l’aboutissement d’un processus de maturation diplomatique du continent africain dans les institutions multilatérales, mais aussi un rééquilibrage attendu du soft power mondial. Cette recomposition serait d’autant plus significative qu’elle pourrait renforcer des alliances structurelles entre pays du Sud, tout en consolidant les objectifs de l’Agenda 2063 de l’Union africaine et ceux de la coopération culturelle Sud-Sud. Le retrait des États-Unis de l’UNESCO ne signe pas un affaiblissement de l’organisation, mais plutôt un tournant. Il ouvre une brèche dans laquelle des leaderships alternatifs, porteurs d’une vision inclusive, peuvent émerger. La candidature de Firmin Édouard Matoko cristallise cette dynamique : elle représente à la fois une opportunité politique, une légitimité institutionnelle et une ambition stratégique pour faire de l’UNESCO un véritable moteur de la diplomatie culturelle mondiale, à l’ère post-occidentale. Noël Ndong