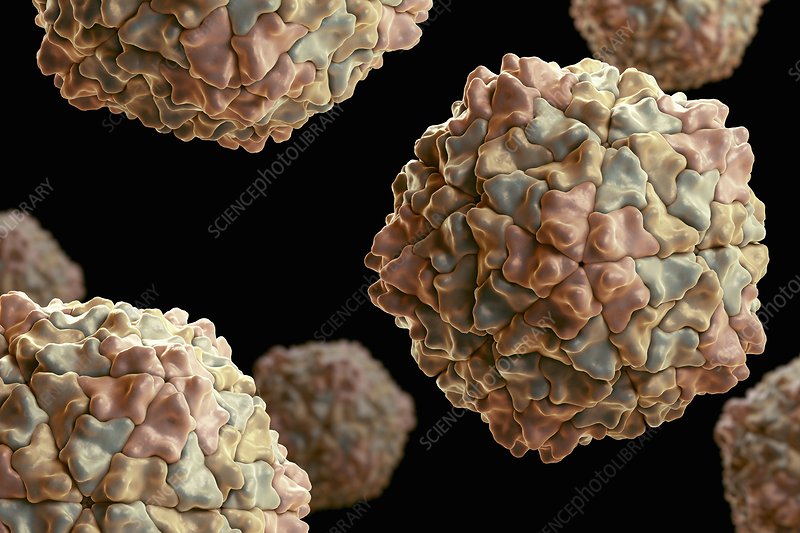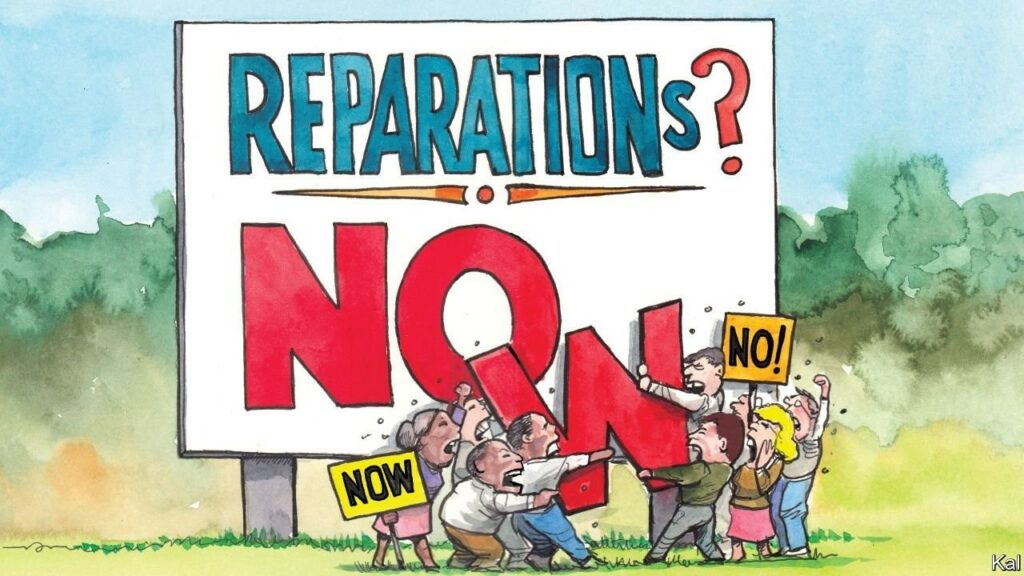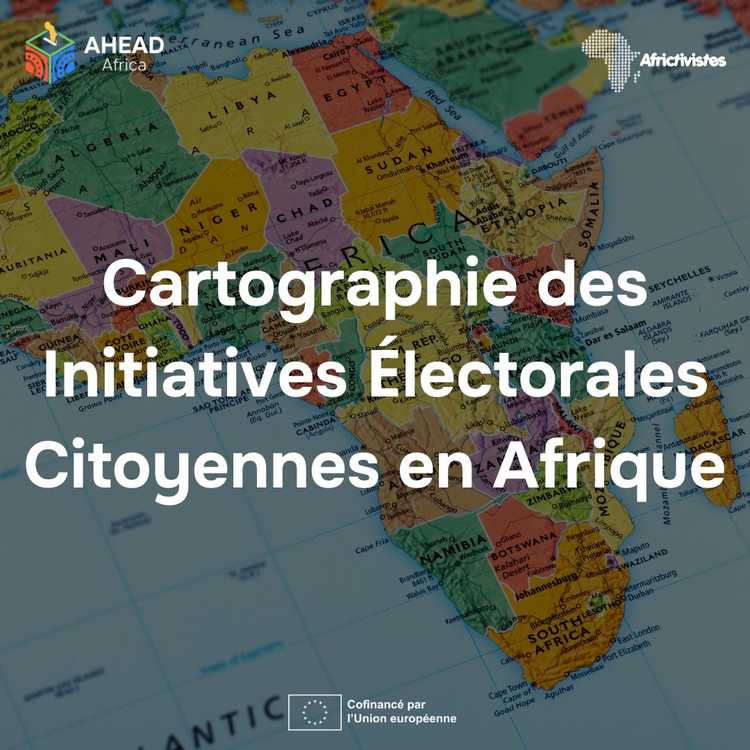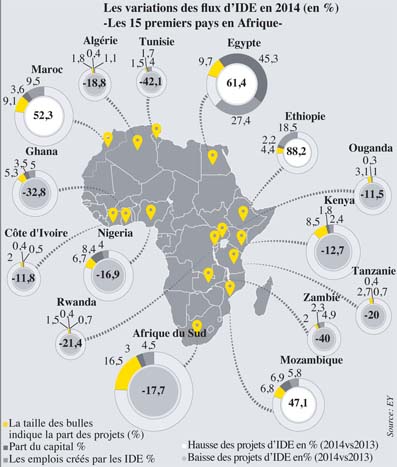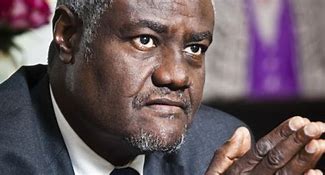Afrique centrale/Le virus du riz : une bombe agricole silencieuse
Face au Rice Yellow Mottle Virus (RYMV), le Cameroun et ses voisins au cœur d’un enjeu agricole, sanitaire et stratégique continental. « Le RYMV n’est pas qu’un virus agricole, c’est une menace systémique pour la souveraineté alimentaire africaine », selon Dr. Alice Nkosi, virologue agricole. Présent dans plus de 25 pays, le virus de la panachure jaune du riz (RYMV) provoque des pertes de 20 à 80 %, soit jusqu’à 7 millions de tonnes de riz perdues chaque année sur le continent. Pour un aliment qui constitue une base alimentaire pour plus de 200 millions de consommateurs en Afrique centrale et de l’Ouest, le danger est palpable. Le Cameroun, avec plus de 300 000 hectares de riziculture, est particulièrement vulnérable. « Le corridor rizicole de l’Adamaoua au Lac Tchad agit comme un accélérateur épidémiologique », prévient Dr. Jean-Claude Nguema, co-auteur de l’étude publiée dans PLoS Pathogens. Le pays constitue un nœud stratégique régional, exposé aux dynamiques de diffusion venues du Sahel, de l’Afrique de l’Est et des grandes zones forestières du bassin du Congo. « La circulation non réglementée des semences et la mobilité transfrontalière des éleveurs et commerçants facilitent une propagation virale invisible mais rapide », explique Pr. Aminata Diallo, agronome. Contrairement à d’autres virus végétaux, le RYMV se transmet non seulement par insectes, mais aussi via les outils agricoles, les animaux (bœufs, oiseaux), et les contacts humains. Il échappe aux dispositifs classiques de contrôle phytosanitaire. Un enjeu de sécurité alimentaire et géopolitique : dans un contexte d’inflation céréalière mondiale, d’instabilité climatique, et de dépendance persistante aux importations asiatiques, l’expansion du RYMV en Afrique centrale pourrait rapidement devenir un facteur aggravant de tensions sociales. « La réponse doit être multilatérale, transfrontalière et coordonnée. Le virus ignore les frontières ; notre réponse ne peut pas en avoir » — Dr. Samuel Adebayo, conseiller régional en sécurité alimentaire (CEDEAO) Il serait urgent d’appuyer les réseaux de surveillance virale, sécuriser les flux de semences, former les agriculteurs, et intégrer le risque RYMV aux stratégies nationales de sécurité alimentaire devient une priorité. Sans réaction rapide, la région pourrait faire face à une crise rizicole de grande ampleur. Noël Ndong
Afrique centrale/Le virus du riz : une bombe agricole silencieuse Read More »