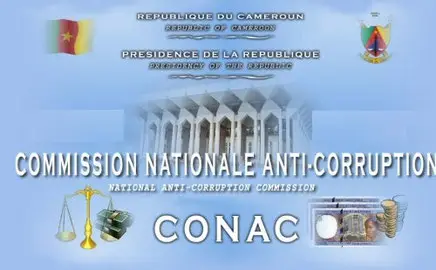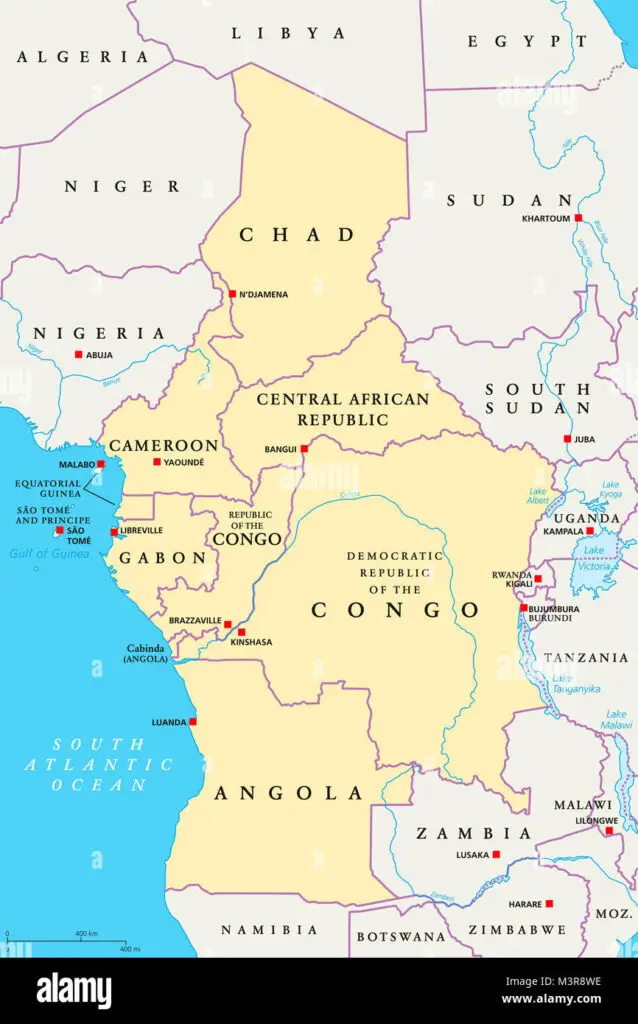Cameroun : 154 établissements scolaires privés fermés, le MINESEC déclenche une onde de choc à la veille de la rentrée
À quelques semaines de la rentrée 2025/2026, le Ministère des Enseignements Secondaires (MINESEC) a ordonné la fermeture de 154 établissements privés à travers le pays. Une décision inédite, prise par arrêté ministériel le 29 juillet 2025, qui bouleverse profondément le paysage éducatif camerounais. Selon le communiqué officiel du MINESEC, ces fermetures concernent des structures en infraction avec les formalités légales de création, d’ouverture ou d’extension. Le ministère évoque des « carences ou violations » compromettant la conformité de ces établissements, tant sur le plan administratif que pédagogique. Un assainissement urgent, mais brutal Cette mesure d’assainissement du secteur éducatif privé intervient dans un contexte de prolifération d’écoles non homologuées. Le chiffre – 154 établissements – témoigne d’un dysfonctionnement structurel. « Il ne s’agit pas d’une simple régulation, mais d’une crise révélée par un laisser-faire institutionnel prolongé », analyse un inspecteur régional du MINESEC sous couvert d’anonymat. Les écoles concernées sont réparties sur l’ensemble du territoire national, affectant potentiellement des milliers d’élèves qui se retrouvent sans établissement à la veille de la rentrée. Un parent à Douala confie : « Mon fils est inscrit depuis deux ans dans une école maintenant déclarée illégale. Personne ne nous avait alertés auparavant ». Vigilance accrue et recours à l’administration Face à l’urgence, le ministre a lancé un appel à la vigilance à toute la communauté éducative, exhortant les familles à se tourner uniquement vers les structures agréées. Le site officiel du ministère (www.minesec.gov.cm) publie désormais la liste des écoles autorisées. « Les parents doivent vérifier systématiquement le statut des établissements avant toute inscription », insiste un responsable du MINESEC à Yaoundé. Les services déconcentrés du ministère ont été mobilisés pour accompagner les familles dans cette phase de réorientation. Vers une réforme du contrôle éducatif privé ? Au-delà de l’urgence, cette affaire soulève une question de fond : comment ces établissements ont-ils pu opérer en toute illégalité ? Ce scandale met en lumière les limites du système d’autorisation préalable, souvent trop lent ou peu suivi. Le MINESEC promet de renforcer les contrôles à l’avenir. Reste à savoir si cette secousse provoquera une réforme durable ou s’il s’agira d’un énième coup d’éclat sans effet profond. Pour l’instant, des milliers d’élèves et de familles camerounaises sont plongés dans l’incertitude à quelques semaines de la reprise des cours.