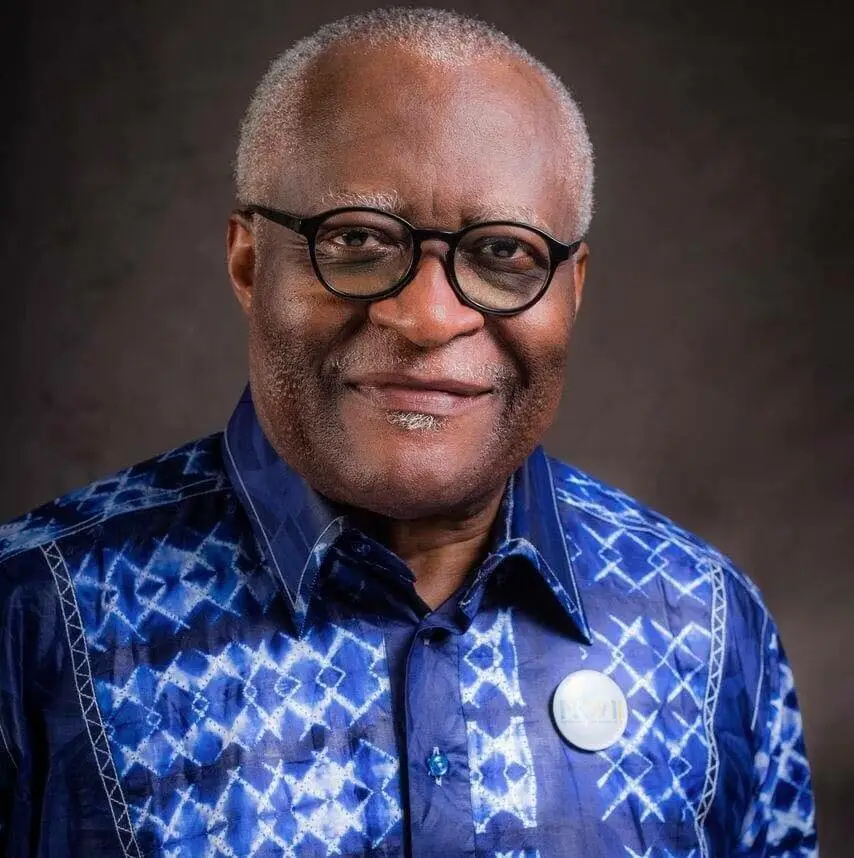Cameroun : le rejet de la requête déclarant Paul Biya inéligible
Alors que la présidentielle du 12 octobre approche, le Conseil constitutionnel camerounais a rejeté la requête déposée par Me Akere Muna, candidat déclaré, visant à faire constater l’inéligibilité du président sortant Paul Biya. Ce dernier, âgé de 92 ans et au pouvoir depuis 1982, brigue un huitième mandat. Si la décision n’est pas surprenante au regard du cadre juridique actuel, elle soulève des interrogations sur l’état du droit électoral, le fonctionnement institutionnel et la perception de l’équité démocratique au Cameroun. Une requête politiquement audacieuse mais juridiquement fragile Dans son recours, Akere Muna invoquait l’inaptitude présumée de Paul Biya à gouverner, soulignant son âge avancé et sa faible visibilité publique. Il faisait notamment appel à l’article 118 du code électoral, qui prévoit qu’un candidat peut être déclaré inéligible s’il se trouve sous l’influence ou la dépendance d’un tiers ou d’une puissance étrangère. Mais le Conseil constitutionnel a estimé que les éléments apportés ne constituaient pas une preuve suffisante d’une telle dépendance. Aucun certificat médical, ni élément factuel concret ne permettait d’établir un empêchement juridique à la candidature du président sortant. Juridiquement, la Constitution camerounaise ne prévoit ni limite d’âge ni évaluation médicale obligatoire pour les candidats à la présidence. Le cadre légal laisse donc peu de marge pour une exclusion sur la base de l’âge ou de la capacité physique, à moins d’une procédure médicale officielle – qui reste absente du droit en vigueur. Une décision conforme à la loi, mais pas sans débats Le rejet de la requête est cohérent avec les textes en vigueur, mais il illustre aussi les limites du système électoral camerounais, où le droit reste peu adapté aux préoccupations modernes sur la gouvernance, la transparence et la responsabilité. Selon plusieurs observateurs, le recours d’Akere Muna visait surtout à ouvrir un débat public sur la légitimité démocratique du pouvoir en place. Dans ce sens, même rejetée, sa démarche a permis de ramener sur le devant de la scène des questions essentielles : l’alternance, la vitalité institutionnelle, l’état de santé des dirigeants, ou encore l’aptitude des juges constitutionnels à exercer leur mission de manière indépendante. Pour certains juristes, la décision du Conseil reflète la prédominance du formalisme juridique sur les considérations d’intérêt public, tandis que d’autres soulignent le risque de dérive si l’on permettait des exclusions de candidature sur des critères subjectifs ou politiques. Entre statu quo institutionnel et expression d’un malaise politique Cette affaire révèle surtout un clivage profond entre la légalité et la légitimité, entre un système qui fonctionne selon les règles établies, et une opinion publique qui aspire à plus de transparence, de renouvellement et de contrôle démocratique. L’âge de Paul Biya, son style de gouvernance très discret, et l’absence apparente de préparation à la succession renforceraient l’idée d’un pouvoir verrouillé, peu perméable à la critique, selon certains. D’un autre côté, ses partisans insistent sur la stabilité politique qu’il incarne, sur son droit à se présenter comme tout citoyen, et sur le rôle du peuple souverain dans le choix de ses dirigeants – à travers les urnes, non les tribunaux. Un moment révélateur à quelques semaines d’un scrutin crucial Le rejet de la requête d’Akere Muna ne constitue pas un événement juridique exceptionnel, mais il marque un moment politique significatif dans une élection aux enjeux élevés. Il interroge la place des institutions dans la régulation du pouvoir, la capacité de l’opposition à se faire entendre, et l’état général du débat démocratique dans un pays où l’alternance n’a jamais été vécue au sommet de l’État. La présidentielle de 2025 s’annonce comme un test pour la crédibilité du processus électoral, autant que pour la résilience d’un système en proie aux critiques mais toujours solidement ancré. La controverse reste la seule façon pour l’opposition de rester visible – même si cela ne modifie pas l’issue judiciaire.
Cameroun : le rejet de la requête déclarant Paul Biya inéligible Read More »