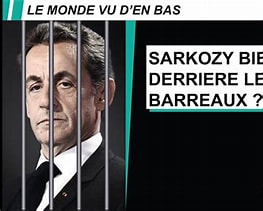Election présidentielle 237 – Analyse internationale : réactions et enjeux
L’élection présidentielle du 12 octobre 2025 au Cameroun, dont la proclamation officielle du vainqueur est attendue pour le 27 octobre, retient l’attention bien au-delà des frontières nationales. Chancelleries occidentales, organisations régionales et bailleurs de fonds scrutent de près ce scrutin aux allures de test pour la stabilité politique d’un pays clé d’Afrique centrale. Des partenaires internationaux sur leurs gardes À New York, les Nations unies ont fait part de « préoccupations sérieuses » quant à « la restriction de l’espace civique » et aux « pressions sur les médias » avant le vote. Le Parlement européen, lui, avait déjà tiré la sonnette d’alarme en avril 2025, condamnant « les violations systématiques des droits des journalistes » et exhortant Bruxelles à exercer une « pression diplomatique et économique » sur Yaoundé. Malgré ce ton critique, l’Union européenne continue d’appuyer le Cameroun : un prêt de 91 millions € a été accordé pour trois ans, afin de soutenir les infrastructures et l’investissement privé. Paris, acteur historique, adopte une prudente neutralité. Le Quai d’Orsay a simplement recommandé la vigilance à ses ressortissants en raison de « tensions post-électorales », tout en réaffirmant « son attachement à la stabilité et à la démocratie ». Le Fonds monétaire international, pour sa part, poursuit son programme d’appui. En mars 2025, 73,5 millions $ ont été débloqués dans le cadre de la Facilité élargie de crédit (IMF). Ces partenaires étrangers se tiennent sur une ligne dite de « vigilance constructive » : soutien économique maintenu, mais conditionné à une transparence accrue et au respect des droits civiques. Entre enjeux géopolitiques et géoéconomiques Producteur de cacao, de pétrole et de bois, entre autres ressources naturelles, le Cameroun affiche une croissance modérée de 3,6 % en 2025 selon la Banque mondiale . Mais près d’un quart de la population (23 %) vivrait encore sous le seuil de pauvreté. La stabilité politique demeure donc une condition essentielle pour rassurer les investisseurs. D’après La Voix des Entreprises, toute contestation prolongée du scrutin risquerait de faire reculer les investissements directs étrangers et d’alourdir le coût du financement extérieur. Sur le plan stratégique, Yaoundé navigue entre plusieurs influences : la France, partenaire historique ; la Chine, devenue premier bailleur en infrastructures ; et la Russie, de plus en plus présente sur le terrain sécuritaire. « Paris semble privilégier la stabilité à la démocratie », estime un rapport du Lansing Institute, soulignant la difficulté pour les Occidentaux d’équilibrer principes démocratiques et intérêts régionaux. À l’échelle régionale, une déstabilisation du Cameroun, pivot logistique et commercial de la CEMAC, affecterait l’ensemble de l’Afrique centrale. Le Foreign Affairs Forum note qu’un afflux de réfugiés ou une perturbation du corridor Douala-N’Djamena pourrait « fragiliser les échanges régionaux et les équilibres frontaliers ». Un contexte sécuritaire sous tension Le pays reste confronté à deux fronts de violence : la crise séparatiste dans les régions anglophones et les attaques récurrentes de Boko Haram dans l’Extrême-Nord. Les tensions post-électorales aggravent ces fragilités. Des bureaux du parti au pouvoir, le RDPC, ont été incendiés, et plusieurs rassemblements de l’opposition interdits. Selon des observateurs, une contestation prolongée ou une répression excessive pourrait éroder davantage l’État de droit et renforcer les groupes armés locaux. « Le risque, c’est une dérive à la soudanaise : un pays politiquement figé, économiquement sous pression, et militairement exposé », avertit un diplomate européen. Un scrutin sous haute surveillance Au-delà de la bataille électorale, l’enjeu est donc triple : préserver la légitimité démocratique interne, rassurer les partenaires économiques et éviter une dérive sécuritaire. Les chancelleries occidentales, tout en prônant la retenue, attendent des signaux clairs sur l’ouverture politique. Les prochains jours seront décisifs. La proclamation officielle du 27 octobre sera observée à Yaoundé, mais aussi à Bruxelles, Paris et Washington : autant pour ce qu’elle dira du vainqueur que pour ce qu’elle révélera de la capacité du Cameroun à conjuguer stabilité et démocratie.
Election présidentielle 237 – Analyse internationale : réactions et enjeux Read More »