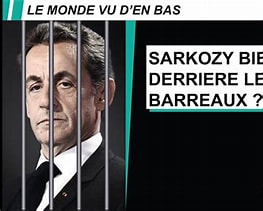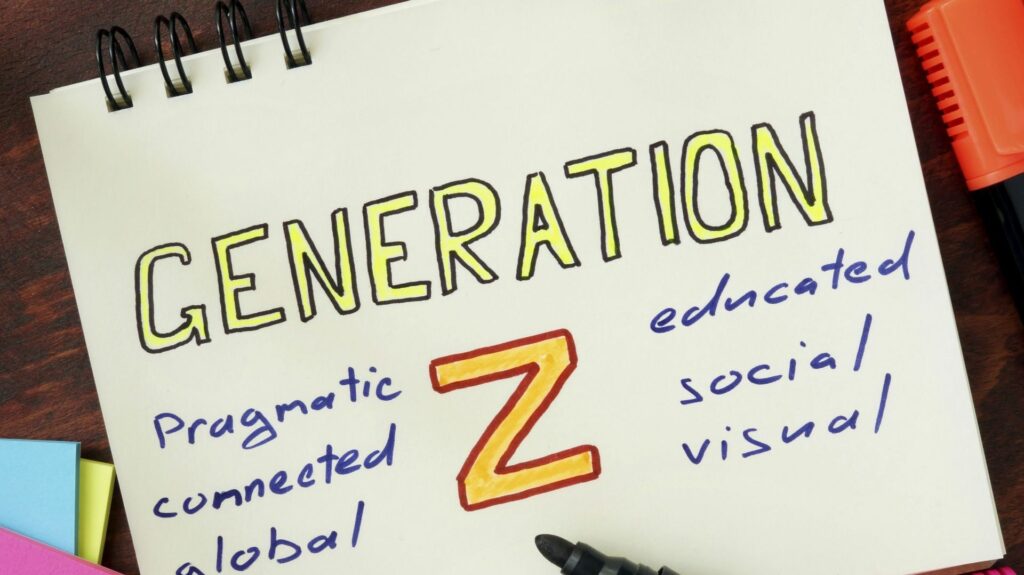Côte d’Ivoire (Afrique de l’Ouest) : entre incertitudes économiques et risques sécuritaires régionaux
La présidentielle ivoirienne de samedi 25 octobre 2025, se joue dans un climat tendu, où la contestation politique menace la stabilité économique du pays et pourrait déstabiliser la région du Sahel. Alors que les derniers meetings de campagne battent leur plein à quelques jours de la présidentielle ivoirienne de samedi, le pays fait face à une double incertitude : la répression politique interne et les risques d’instabilité économique et sécuritaire dans une région déjà fragilisée. En Côte d’Ivoire, où près de 9 millions d’électeurs sont appelés aux urnes, la situation est loin d’être apaisée. Le Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix (RHDP) d’Alassane Ouattara, candidat à un quatrième mandat, a bouclé sa campagne dans un climat de tensions avec l’opposition, qui dénonce l’exclusion des candidats Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam, et des accusations de fraude. D’un point de vue économique, le risque de déstabilisation est majeur pour les investisseurs étrangers. Le pays, l’une des plus grandes économies de l’Afrique de l’Ouest, est un pôle d’attraction pour les investissements directs étrangers (IDE), notamment dans les secteurs du pétrole, de l’agriculture, et des infrastructures. Toutefois, la répression politique actuelle, avec quatre morts et plusieurs dizaines de prisonniers depuis octobre, risque de provoquer un ralentissement économique. Les secteurs clés, tels que l’agriculture (cacao, café), l’exploitation pétrolière et les infrastructures, qui représentent une part importante des exportations ivoiriennes et de l’économie nationale, pourraient voir leurs flux financiers affectés par un climat d’instabilité. La répression des manifestations et l’incertitude politique entraînent une augmentation du risque pays, ce qui pourrait désinciter les investisseurs étrangers et ralentir la reprise économique post-COVID, notamment dans les zones industrielles de San Pedro et Yamoussoukro. Du côté sécuritaire, l’instabilité politique intérieure pourrait avoir des répercussions sur la sécurité régionale. La Côte d’Ivoire, en raison de son rôle de pilier dans la lutte contre le terrorisme au Sahel et dans le Bassin du Lac Tchad, demeure un acteur stratégique dans la force conjointe du G5 Sahel. Une polarisation politique accrue et une violence post-électorale pourraient affaiblir la coopération régionale et perturber les missions de maintien de la paix dans le Sahel. La région, déjà sous pression avec l’avancée des groupes armés djihadistes, pourrait se voir confrontée à de nouvelles tensions si des violences éclatent en Côte d’Ivoire, déstabilisant ainsi l’ensemble du bloc ouest-africain. Les implications géopolitiques de cette élection sont également notables. Les partenaires occidentaux, notamment la France et les États-Unis, suivront de près l’évolution de la situation. La Côte d’Ivoire, un acteur clé de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF), pourrait voir ses relations commerciales affectées par des sanctions diplomatiques ou une réduction des aides au développement en cas de fraude électorale ou de violences post-électorales. Le maintien de l’ordre démocratique et la gestion pacifique des résultats sont donc des enjeux cruciaux, non seulement pour la Côte d’Ivoire mais pour l’ensemble de la sous-région. Dans ce contexte complexe, la stabilité économique et la sécurité régionale restent étroitement liées. L’élection de samedi pourrait définir non seulement l’avenir politique de la Côte d’Ivoire mais aussi son rôle dans la réorganisation géopolitique de l’Afrique de l’Ouest.