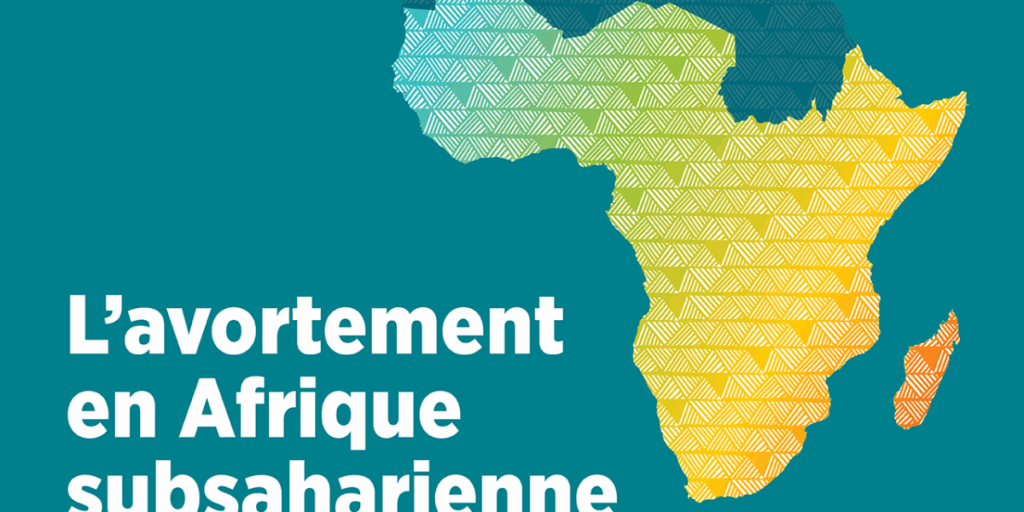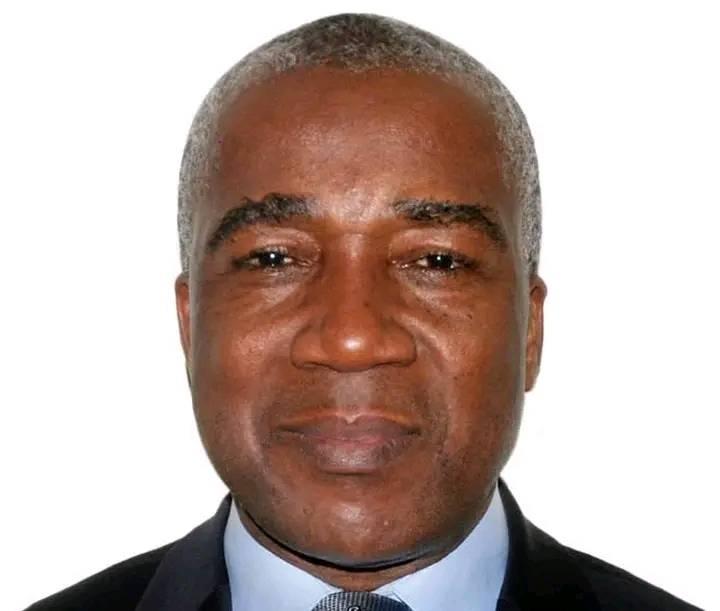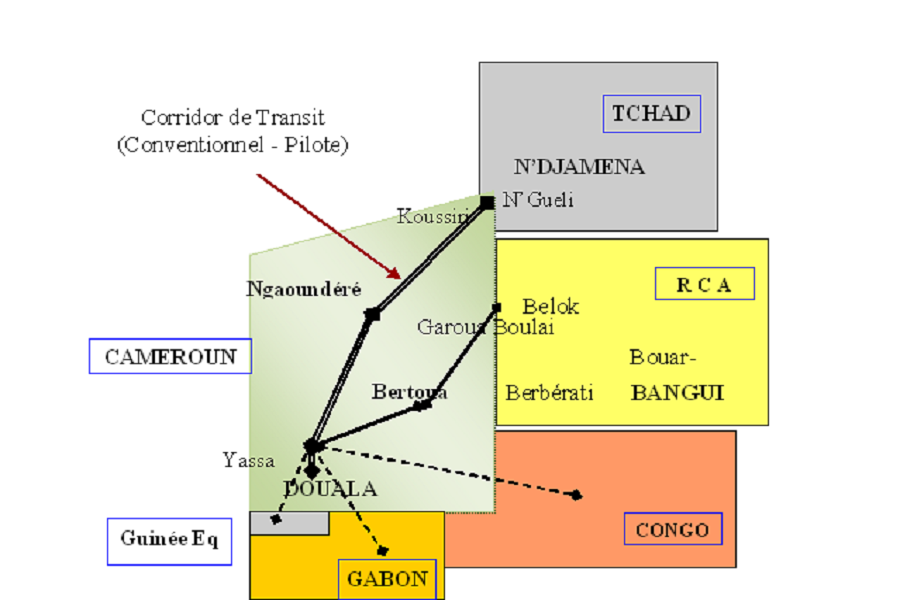Uranium du Niger : la plainte de Paris ou le symptôme d’une défaite stratégique
Quand Niamey inverse le rapport de force face à Orano et expose les failles françaises La plainte déposée par Orano et l’ouverture, en plein cœur de l’hiver, d’une enquête du parquet de Paris pour « vol en bande organisée au profit d’une puissance étrangère » ne relèvent pas du simple contentieux industriel. Elles marquent un tournant géopolitique majeur dans le bras de fer entre la France et le Niger, révélateur d’une perte d’influence profonde de Paris au Sahel. Depuis la prise de pouvoir militaire de juillet 2023, le groupe français – ex-Areva – a vu s’effondrer en quelques mois une présence vieille de plus d’un demi-siècle. Les mines de Somaïr, Cominak et Imouraren, piliers de l’approvisionnement français en uranium depuis les années 1970, ont été nationalisées par le régime du général Abdourahamane Tiani au nom du « droit légitime du peuple nigérien à exploiter ses ressources ». Une rupture brutale avec un modèle hérité de la Françafrique. L’affaire prend une dimension explosive avec la disparition présumée de 1 000 tonnes d’uranium civil, évaluées à 160 millions d’euros, du site d’Arlit. Les soupçons d’un transfert vers la Russie, via le Burkina Faso et possiblement le Togo, transforment un litige commercial en enjeu de sécurité internationale et d’intelligence économique. Paris redoute moins la perte financière que le basculement stratégique : voir une ressource clé de son parc nucléaire passer sous contrôle de puissances concurrentes. Un contentieux juridique aux chances limitées Sur le plan strictement juridique, les chances de succès de la plainte française restent incertaines. Certes, un tribunal arbitral a estimé que l’État nigérien ne pouvait ni vendre ni transférer l’uranium produit par la Somaïr. Mais dans les faits, le contrôle territorial, militaire et logistique appartient désormais à Niamey. Le droit international de l’investissement se heurte ici à une réalité politique : celle d’un État souverain assumant la rupture, prêt à supporter le coût judiciaire au nom d’un gain stratégique à long terme. L’ouverture de l’enquête à Paris apparaît ainsi autant comme un outil judiciaire que comme un signal politique : montrer que la France n’abandonne pas le terrain, maintenir une pression diplomatique et dissuader d’éventuels partenaires étrangers. Mais cette démarche révèle aussi une faiblesse : Paris agit désormais depuis l’extérieur, en réaction, là où Niamey impose le tempo. Le cœur du contentieux : le prix et la valeur stratégique de l’uranium Derrière le conflit, une question centrale : le prix de l’uranium nigérien. Pendant des décennies, la France a acheté le kilo d’uranium à des tarifs largement inférieurs aux cours mondiaux – autour de 30 à 40 dollars le kilo, contre des pics dépassant aujourd’hui 100 dollars sur le marché international. Pour Niamey, la nationalisation n’est pas qu’un acte politique : c’est une reconquête économique. Le Niger a désormais ouvertement affiché sa volonté de diversifier ses partenaires : Russie, Iran, Chine, et acteurs non occidentaux du nucléaire civil. Le mémorandum signé avec Rosatom en juillet s’inscrit dans cette logique. Il ne s’agit plus seulement de vendre de l’uranium, mais de changer de système d’alliances. Une stratégie du faible au fort Face à une France affaiblie diplomatiquement, isolée militairement après son retrait du Sahel et dépendante de l’uranium pour son parc nucléaire, le Niger déploie une stratégie asymétrique redoutablement efficace. En nationalisant, en communiquant sur la souveraineté, en judiciarisant à son tour le dossier (accusations de déchets radioactifs), Niamey retourne le narratif : l’exploitant devient l’accusé. Cette affaire dépasse Orano. Elle symbolise l’inversion du rapport de force Paris–Niamey, la fin d’un cycle et l’entrée du Niger dans une géoéconomie assumée des ressources. La plainte française, plus qu’une arme décisive, apparaît comme un aveu de perte de contrôle. Dans le nouveau Sahel, l’uranium n’est plus seulement une matière première : c’est une arme stratégique.
Uranium du Niger : la plainte de Paris ou le symptôme d’une défaite stratégique Read More »