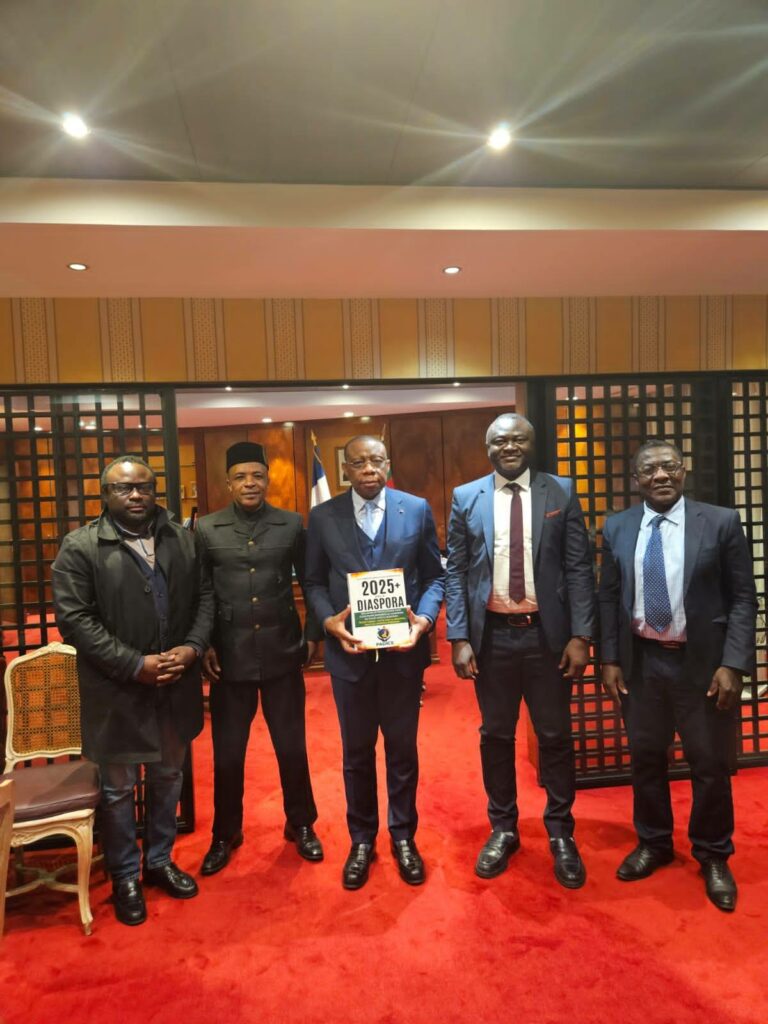RDC : la MONUSCO prolongée, le multilatéralisme sous tension
Malgré un vote unanime au Conseil de sécurité, la reconduction de la mission onusienne révèle des fractures profondes entre puissances et une redéfinition du rôle africain dans la gestion des crises. Le Conseil de sécurité des Nations unies a décidé de prolonger d’un an le mandat de la Mission de l’ONU pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO), dans un contexte sécuritaire toujours critique dans l’est du pays. Adoptée à l’unanimité par les quinze membres, la résolution masque toutefois des divergences diplomatiques croissantes sur la nature, les limites et l’utilité stratégique de la mission. Sur le terrain, la situation reste alarmante. Les violences persistantes impliquant le mouvement rebelle M23, l’armée congolaise et divers groupes armés continuent de provoquer déplacements massifs de populations et instabilité régionale, dans une zone au cœur des équilibres sécuritaires des Grands Lacs. Selon l’ONU, plus de 6,5 millions de personnes sont déplacées internes en RDC, un chiffre parmi les plus élevés au monde. Derrière le consensus formel, les débats au Conseil ont révélé une opposition nette entre les puissances occidentales et le duo sino-russe. Les États-Unis ont accusé le Rwanda de soutenir le M23, appelant à un rôle plus actif de la MONUSCO dans l’appui aux initiatives de cessez-le-feu issues des discussions menées à Washington et à Doha. La France, rédactrice du texte, a défendu une approche pragmatique visant à préserver le cœur du mandat tout en l’adaptant aux dynamiques diplomatiques en cours. À l’inverse, la Russie et la Chine ont dénoncé ce qu’elles considèrent comme une politisation excessive de la mission. Moscou a évoqué un « compromis difficile », tandis que Pékin a mis en garde contre toute instrumentalisation de la MONUSCO au service d’agendas extérieurs au cadre onusien, plaidant pour une interprétation stricte du principe de souveraineté. Les membres africains du Conseil, réunis au sein du groupe A3 Plus, ont tenté de rééquilibrer le débat. Ils ont insisté sur la nécessité d’un leadership africain renforcé, mettant en avant les efforts de médiation de l’Union africaine et des organisations régionales, notamment les initiatives pilotées par le Togo. Cette position traduit une volonté croissante du continent de peser davantage dans la résolution de ses propres crises. La résolution maintient les effectifs actuels de la MONUSCO et ses missions principales de protection des civils et d’appui aux autorités congolaises, tout en prévoyant un soutien encadré à un éventuel cessez-le-feu. Elle ouvre aussi la voie à des ajustements futurs du mandat, en fonction de l’évolution sécuritaire. Dans un contexte de rivalités géopolitiques accrues, la prolongation de la MONUSCO illustre les limites mais aussi la persistance du multilatéralisme onusien face aux crises complexes. Pour la RDC, l’enjeu reste majeur : transformer ce consensus fragile en avancées concrètes pour la paix.
RDC : la MONUSCO prolongée, le multilatéralisme sous tension Read More »