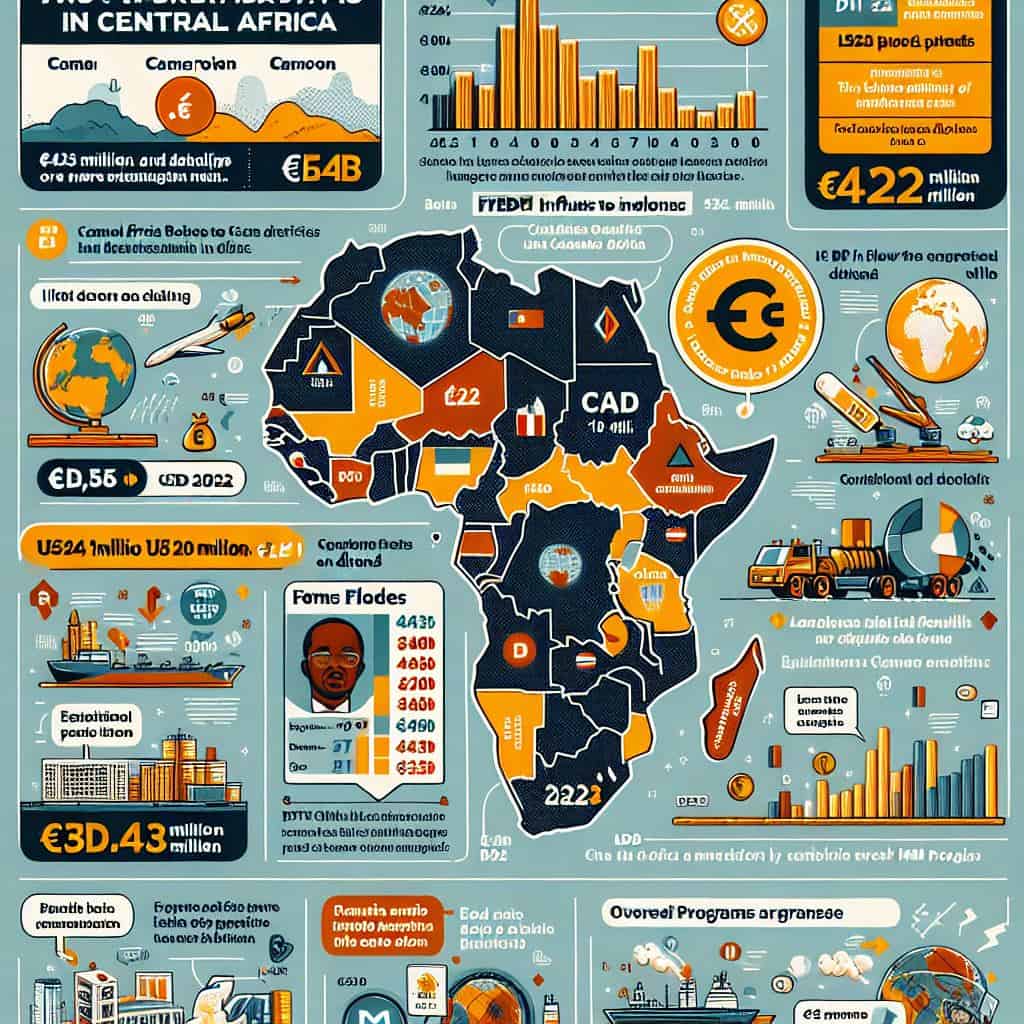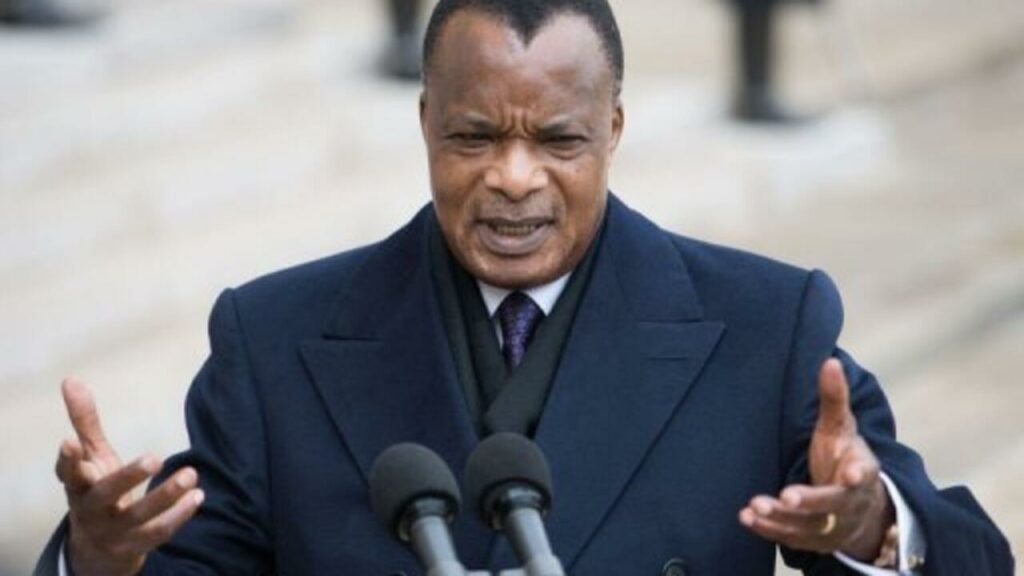SAFACAM, pilier stratégique de l’agro-industrie camerounaise : la méthode Pajot
Sous la direction de Jean-François Pajot, le fleuron historique de l’hévéa conjugue rentabilité, sécurité économique et intelligence stratégique dans un monde sous tension.
SAFACAM, pilier stratégique de l’agro-industrie camerounaise : la méthode Pajot Read More »