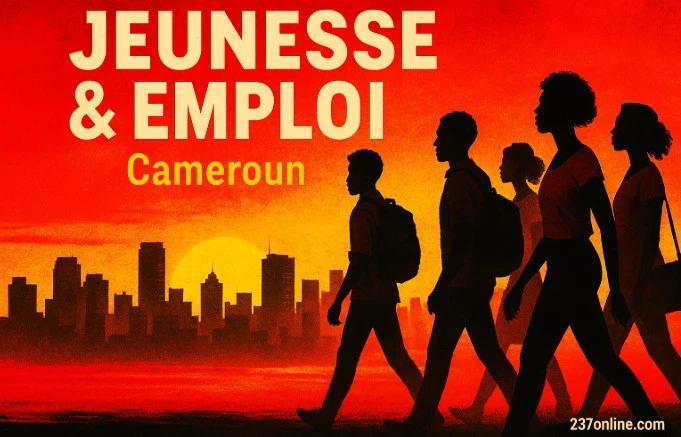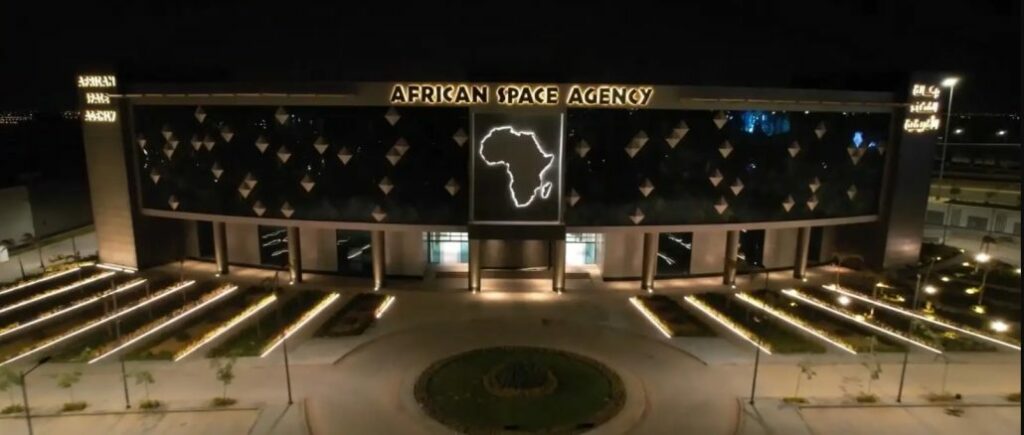Cameroun : zones d’ombre autour de la mort d’Anicet Ekane!
Levée des scellés, autopsie attendue et interrogations persistantes sur les conditions de détention. La mort d’Anicet Ekane continue de susciter interrogations et tensions au Cameroun. Décédé le 1ᵉʳ décembre 2025 au Secrétariat d’État à la Défense (SED), à Yaoundé, plus de 38 jours après son interpellation, le président du Mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie (MANIDEM) laisse derrière lui de nombreuses zones d’ombre quant aux circonstances de son arrestation et de sa détention. Plus de deux mois après son décès, les scellés apposés sur sa dépouille ont été levés le 23 février par le commissaire du gouvernement près le tribunal militaire. Cette décision fait suite à trois requêtes introduites par les avocats de la famille, qui dénonçaient jusque-là une « séquestration » du corps. Les conseils réclament également la communication du rapport d’autopsie, toujours non transmis près de trois mois après la mort de l’opposant. Arrêté à Douala le 24 octobre 2025 avec plusieurs cadres de son parti, au lendemain de l’annonce des résultats de l’élection présidentielle du 12 octobre, Anicet Ekane était poursuivi pour insurrection et rébellion. Les charges faisaient suite à sa reconnaissance de la victoire d’Issa Tchiroma Bakary, alors que le Conseil constitutionnel avait proclamé la réélection de Paul Biya pour un huitième mandat consécutif. Le chef de l’État sortant, Paul Biya avait été déclaré vainqueur dans un scrutin contesté par une partie de l’opposition. Figure historique de la contestation politique et voix critique du système en place, Anicet Ekane, 74 ans, incarnait une génération d’opposants engagés de longue date pour l’alternance et la réforme des institutions. L’annonce de son décès en détention a provoqué une onde de choc à travers le pays, alimentant les débats sur le respect des droits fondamentaux, les conditions de garde à vue et le traitement réservé aux détenus politiques. La levée des scellés pourrait ouvrir la voie à l’organisation des obsèques. Mais pour la famille et les partisans du défunt, l’enjeu dépasse désormais le cadre funéraire : ils exigent toute la lumière sur les causes exactes du décès et les responsabilités éventuelles, dans un climat politique déjà tendu.
Cameroun : zones d’ombre autour de la mort d’Anicet Ekane! Read More »